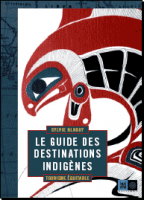On hésite à dire que le tourisme indigène est né en Afrique, berceau de l’humanité... N’empêche, c’est sur ce continent que les initiatives sont les plus nombreuses, les plus diversifiées et les mieux organisées à l’échelle des pays. Le souci de se fédérer, de promouvoir les offres sur des sites Internet, vient des pays anglophones comme la Namibie, l’Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Botswana. Ainsi la Nacobta, en Namibie, est-elle la plus ancienne association africaine de tourisme indigène et a servi de banc d’essai à nombre d’autres associations à travers le continent : Ucota, en Ouganda, par exemple s’est calqué sur le modèle namibien. Ces réseaux de tourisme communautaire sont nés d’une forte volonté d’aider les dites communautés à mieux gérer leurs ressources naturelles et sont le plus souvent un volet, privilégié, d’un programme plus vaste de « co-gestion communautaire des ressources naturelles » dit CBNRM (Community based natural resource management). Ce mouvement est financé par la coopération et l’aide au développement allemande, hollandaise, anglaise et suédoise. Le tourisme de masse qui fait recette avec les safaris a généré la construction de nombreuses lodges luxueuses et représente une menace croissante pour les communautés locales. Au Kenya notamment, les nombreuses initiatives des communautés Maasaï visent à se réapproprier la faune sauvage en organisant par exemple leur version, à pied, sans « filet », des safaris traditionnels, en favorisant une vision plus authentique de leur culture trop souvent folklorisée par les opérateurs étrangers. Si, dans les pays anglophones, l’accent est mis sur la conservation, la préservation de la faune sauvage et la pérennité des parcs nationaux – héritage direct des préoccupations coloniales –, l’approche dans les pays d’Afrique francophone est très différente. Elle s’intéresse davantage aux cultures humaines, s’inscrit dans des démarches de type humanitaire, un souci de solidarité Nord Sud et s’inspire directement du mouvement du commerce équitable. On y parle plutôt de tourisme villageois, équitable et solidaire. Les initiatives naissent souvent de rencontres entre des individus, découlent d’amitiés particulières débouchant sur des associations de soutien, des réseaux d’entraide accompagnées par des ONG de développement ou plus rarement des voyagistes. L’immersion au village, le partage des activités quotidiennes, l’itinérance le temps d’une Méharée ou d’une caravane de sel caractérise l’offre de cette Afrique. Ces séjours deviennent des moments d’échanges, d’apprentissage et de compréhension réciproques. Les gouvernements de la France, l’Espagne, l’Italie et du Portugal, très concernés par les liens tissés avec leurs anciennes colonies, interviennent dans un second temps pour fédérer ces initiatives au niveau national. Ainsi l’UNAT en France fédére-t-elle une vingtaine d’ONG et associations qui initient, accompagnent et commercialisent ces séjours innovants. Les bénéfices de ce tourisme indigène sont reconvertis, en Afrique anglophone, plutôt dans la réhabilitation des écosystèmes tandis qu’en Afrique francophone, ils sont en priorité réinvestis pour améliorer les conditions de vie des villageois : éducation, santé publique, développement agricole. Or, on peut d’ores et déjà constater que les séjours conçus par les communautés autochtones de l’ensemble de l’Afrique aujourd’hui se rapprochent. Ainsi, au-delà des traces laissées par la colonisation, le tourisme indigène contribuera peut-être à corriger les déséquilibres de l’histoire, aidant l’Afrique à trouver une unité et le voyageur à s’interroger sur la rupture nature/culture affichée par nos sociétés occidentales.
Initiatives d’ ecotourisme autochtone dans le monde.